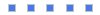

Alors 2010, l’année de la glisse ? Non, il y a bien longtemps qu’Andrew Lau est déjà au plus bas, enfoui sous 50m de neige, se rappelant les mauvais tours de manège en 3D, les courses insipides, la romance interraciale d’un Daisy (2005) et le véritable échec de Confession of Pain (2006). Quoi de mieux pour rebondir que de faire appel à la star Donnie Yen et de prolonger la série Fist of Fury (1995, déjà avec le père Donnie), le loustic étant un vrai gage de qualité au vu de ses performances martiales affolantes. Co-produit et co-écrit avec Gordon Chan, auteur de récents navets mais responsable de Fist of Legend (1994), Legend of the Fist: Return of Chen Zhen revient dans le Shanghai des années 30 occupé par les japonais. Chen Zhen (Donnie Yen) travaille en tant que pianiste au club Casablanca, dans lequel la belle Kiki (Shu Qi) démontre toute l’étendue de ses talents de chanteuse sexy. Cependant, l’étrange homme se faisant appeler Chen Zhen est en fait bien décidé à se venger d’un général japonais (Kahota Ryu, incarnant déjà un rôle de saloperie dans le chef d’œuvre de Lu Chuan, City of Life and Death) responsable de la mort de son maître. Marqué par les atrocités de la Première Guerre Mondiale (on parle de 150 000 chinois envoyés en France) et la mort de ses proches, Chen Zhen n’en est plus à un mort près. A la manière d’un super-héros, le bonhomme revêt une combinaison particulière (celle-là même que portait Bruce Lee dans la série The Green Hornet) et s’empare de la ville pour éradiquer la mafia responsable d’un certain désordre.
D’une violence inouïe, les scènes d’action démontrent qu’Andrew Lau n’a rien perdu de sa verve bourrine. Trop brouillons pour convaincre (la faute à un montage bien trop découpé et à un filmage sans aucune notion de distance), on se tournera vers la brutalité qui émane de chaque affrontement, caractéristique du souhait de Chen Zhen d’en découdre définitivement avec les occupants japonais. Le film relève d’ailleurs d’un manichéisme certain, Andrew Lau insistant avec lourdeur sur la sournoiserie de l’occupant, et sans toutefois attendre la haine absolue d’un Juif Süss (Veit Harlan, 1940 et Lion d’or à Venise !), il renvoie au traitement de n’importe quel film de propagande un tant soit peu haineux. Par exemple, Kahota Ryu sur-joue dans la méchanceté et la sournoiserie, on est loin de son rôle immonde mais formidable dans City of Life and Death et la mise en scène opte régulièrement pour des cadrages rendant la position des généraux japonais méprisante. Dans son approche du film de combat, vaguement héroïque, vaguement historique, The Return of Chen Zhen a déjà vingt ans de retard et prend l’eau dans la plupart de ses compartiments : on devine le sort réservé au personnage de Shu Qi (ici d’origine japonaise mais peu crédible lorsqu’il faut le parler) au fur et à mesure que sa relation évolue avec Chen Zhen, les personnages secondaires frisent le néant (les stars Anthony Wong et Shawn Yue font de la figuration), sauf celui du commissaire froussard qui apporte toute la fraîcheur et l’humour nécessaire pour respirer, ce qui ne manqua pas de faire réagir le public chinois à maintes reprises, surtout lorsque ce dernier remet en place un riche laowai un peu trop confiant et donneur de leçons.
The Return of Chen Zhen a donc ce joli pouvoir régressif lui conférant des allures de série Z calibrée pour des publics bien précis (le public chinois, les amateurs de raclées, de super-héros…), où mauvais goût, clichés et facilités font bon ménage. Mais il y a Donnie Yen, moche mais charismatique dixit ma voisine de gauche. Il faut le voir fumer le cigare, aligner les vols planés les pieds en avant pour dézinguer du vilain, faire la grimace après avoir subi la torture des japonais. Et au final, l’hommage à Bruce Lee lorsqu’il se retrouve face à des dizaines de disciples martiaux et au grand méchant loup, vêtu du célèbre habit blanc et criant comme Bruce. Tatanas est de retour, sans toutefois avoir le charisme de Bruce Lee, ni la sécheresse de ses gestes. Andrew Lau réussit quand même le tour de force de foirer intégralement le final d’un film censé lui redonner un minimum de crédibilité sur la scène Hongkongaise. Démoli par le méchant général, Chen Zen se relève, pense aux morts, déchire son veston blanc classieux et fait le beau avec sa silhouette. Tatanas ressurgit et ne laisse aucune chance à son adversaire. Fondu, écriteau à l’écran nous rappelant que la guerre contre le Japon n’est pas finie, Chen Zen, dans les vêtements de Kato, domine fièrement du haut d’une tour tout Shanghai, générique. Andrew Lau avait un train à prendre ?

S’il y en a un qui n’est pas pressé, c’est bien Tsui Hark. Depuis quand l’attend-t-on ? Dix, quinze ans ? Non, cinq petites années qui en paraissent une éternité. Le barbichu le plus célèbre de la planète Zu avait décidé de prendre des vacances, dans une hôtellerie de plein air pas trop rock’n’roll (All About Women) avec un joli parc aquatique (Missing), en compagnie de quelques copains (Triangle). Dans le genre expériences inoubliables, on a vu mieux. On savait pourtant déjà qu’All About Women allait très sûrement être le dernier faux-pas du cinéaste, lequel avait annoncé la même année la mise en chantier de deux projets alléchants, à savoir le remake du Dragon Gate Inn de King Hu (Tsui Hark avait endossé le rôle de producteur pour l’excellent remake de Raymond Lee en 1992) et ce fameux Detective Dee, adapté du roman de Lin Qianyu, « Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame ». D’un côté comme de l’autre, impossible d’imaginer Tsui Hark de nouveau relégué en Ligue 2 des cinéastes d’Extrême-Orient. Confirmation deux ans plus tard, enfin, avec la sortie de Detective Dee en Chine continentale et à Hongkong (avant un passage à Venise, où il est reparti bredouille), le cinéaste est de retour dans une forme pas vraiment olympique, mais déjà beaucoup plus rassurante.
En retrouvant la verve qui lui permit de réaliser quelques uns de ses films les plus surprenants, Detective Dee repense un peu nostalgique à ces années-là, le rétroviseur incliné vers la Chine mystique et ses personnages folkloriques auteurs d’exploits martiaux qui auront marqué toute une génération de cinéphiles. Detective Dee rappelle donc cette époque-là par ses idées et personnages farfelus générant un certain pouvoir de fascination/excitation, ces moments croustillants qui laissent à croire que Tsui Hark sait encore faire mouvoir les corps dans un espace restreint, avec classe, le temps d’une séquence somptueuse où Dee (Andy Lau) et sa garde du corps (Li Bingbing), pratiquement nus, tentent d’éviter une pluie torrentielle de flèches. Avant l’attaque, les deux protagonistes se sont livrés à un jeu dangereux de provocation non sans rappeler celui de Brigitte Lin et Maggie Cheung (à coups de vêtements) dans Dragon Inn. Légèreté, grâce, et une merveille d’utilisation des espaces. Tsui Hark est bien là. L’autre pirouette du film est d’aller au-delà de son pitch de polar classique (au temps de la dynastie Tang, une série de morts par combustion inquiète l’impératrice Wu, qui décide de faire appel à celui qu’elle emprisonna 8 ans auparavant, afin d’enquêter), en variant au maximum les lieux d’enquête, un marché bondé, une forêt, une grotte ou encore l’intérieur d’une immense statue de Bouddha sont autant d’endroits propices à rendre la mise en scène et les personnages délirants au possible : la séquence de la grotte, rappelant la grotte de la chauve-souris chez Chu Yuan (L'Ile de la bête, 1978), est une merveille de traquenard où Dee et ses acolytes passent en revue des cannibales, un guitariste à six bras ou encore un guerrier masqué pouvant se démultiplier.
La créativité du cinéaste et de son scénariste Chen Kuofu insufflent au film un doux parfum de renouvellement permanent, quitte à sauter les haies très/trop rapidement pour ne pas endormir le spectateur. A ce tarif là, on peut bien pardonner à Detective Dee certains passages dialogués s’étirant trop en longueur et son trop plein d’idées qui finit par déborder. En effet, à trop attendre Tsui Hark à chaque nouvelle séquence, certains détails chagrinent : l’aumônier incarné sous les traits d’un cerf doté de la parole (là où le poisson-chat d’Oncle Boonmee fait glousser ses détracteurs) est là pour faire joli et se la jouer Narnia, les effets spéciaux grandiloquents –et laids- ne sont utilisés que pour réaliser des plans larges sur l’Empire (le film aurait clairement pu s’en passer), le gros tigre de la bande-annonce restera en cage (alors que Dee affronte des cerfs en CGI), et les combats pourtant signés Sammo Hung ne sont pas toujours au niveau (pas de vrai duel entre Tony Leung Ka-Fai et Andy Lau, un sous-boss au crâne d’œuf torché en deux tartines), tous très loin de la lourdeur des coups d’un The Blade ou du dernier grand Wu Xia d’Hongkong, Seven Swords. Le film est plus intéressant dans sa peinture d’un milieu hypocrite et manipulateur, bien aidé par ses faux-semblants, à l’image du cinéma de Tsui Hark, maître en matière d’illusion. Detective Dee dégage ainsi, en dehors de son caractère parfois cheap et de ses facilités d’écriture (on évince les personnages peu intéressants à coups de flèches dans la tête), un sentiment d’illusion permanent, aussi bien au niveau des personnages que de sa narration. Grand manège qui a le mérite de vivre par ses rebondissements plus ou moins attendus, il ne risque pas de laisser de grandes traces indélébiles dans la mémoire du spectateur. Pas facile en effet de réitérer la performance des films les plus épiques du cinéaste que sont Zu, Once upon a time in China et The Blade, pour ne citer qu’eux. Impossible de terminer sur le retour des héros sans évoquer le formidable Reign of Assassins du duo Su Chao-Bin/John Woo, bien qu’il faille préciser que John Woo n’a officié qu’en tant que coréalisateur et coproducteur sur le projet. Une chose est à peu près certaine, le réalisateur de Silk et Better Than Sex s’est surpassé aux côtés du maître puisque les deux compères nous prouvent aujourd’hui qu’il est encore possible de réaliser du wu xia 4 étoiles à l’heure où l’on attend toujours son revival. Aux oubliettes ce que l’on a pu voir, entendre, percevoir depuis Seven Swords (certains diront Tigre et Dragon, d'autres Hero), le wu xia pian renait de ses cendres, emporté par un vague de mysticisme et de poésie, parfois brutale comme terriblement douce et élégante. Le film impressionne dès son introduction, malgré la quantité d’informations, de retours et de sauts dans le temps. On découvre alors Drizzle, membre éminente des assassins du Dark Stone, succomber aux joies du massacre d’un village. Cette dernière possèderait les restes d’un moine lui conférant l’invincibilité. A la suite d’un sublime affrontement avec un moine, jusqu’à la mort de ce dernier, Drizzle décide de changer de vie et d’apparence, en ayant recourt à la chirurgie faciale (à l’aide du venin d’insectes et de feuilles d’or, trois mois de repos). Elle deviendra ce qu’elle est aujourd’hui, une Drizzle incarnée par Michelle Yeoh, resplendissante, proche de la cinquantaine mais toujours élégante lorsqu’il s’agit de manier l’épée. Retirée du monde du crime, elle s’installe dans la capitale et tient une petite échoppe de tissue avec celle qui lui loue une maison. En parallèle, le chef des assassins du Dark Stone, Wheel King, sait pertinemment que Drizzle possède les restes du moine lui conférant des capacités martiales hors-du-commun. Avant de se lancer à sa recherche, il recrute Lei Bin, un dangereux lanceur d’épines amateur de nouilles (Shawn Yue), un magicien (Leon Dai) et Turquoise, une serial-killer sulfureuse, anciennement condamnée à mort et interprétée par Hsu Hsi-Huan. Autre curiosité, l’arrivée en ville d’Ah-Sheng, un joyeux drille un peu gauche (Jeong Wu-Seong) qui tombera rapidement amoureux de Drizzle. La facilité avec laquelle le film manie les genres et les tons est déjà là, en vingt-cinq minutes parfaitement posées : un affrontement d’une grâce absolue, des personnages bien composés et immédiatement reconnaissables, des traits d’humour par paquets (le rendez-vous organisé entre Drizzle et toute une série de prétendants amoureux à la beauté ravageuse, le prétexte de la pluie occasionnant des maladresses de la part d’Ah-Sheng) et une certaine volonté de revenir aux sources du wu xia mystique par petites touches qui donnent tout de suite du baume au cœur : les chorégraphies signées Stephen Tung (qui officiait sur Seven Swords, tiens tiens…) sont racées et élégantes, avec juste ce qu’il faut de câbles et de maîtrise des espaces, la direction artistique et l’utilisation des décors renvoient par instants au cinéma de King Hu, tandis que la sublime direction sonore nous projette immédiatement dans un univers mystique où se côtoient quête d’identité, pouvoir, vengeance et appât du gain. Entre divertissement de haute-volée et hommage à la belle époque. La raison-même de Reign of Assassins tient aussi bien du revival de Michelle Yeoh à l’écran (on ne l’avait pas vu comme ça depuis dix ans) que de la quête (conquête) d’un monde et d’un trésor fascinants. On est d’un côté avec ce qui se fait de mieux dans le genre depuis Seven Swords, et de l’autre, avec un objet de cinéma dédié à une actrice, un personnage exotique fantasmé par l’Occident grâce à James Bond et plus tard, Tigre et Dragon. Etrangement, Reign of Assassins pourrait s’apparenter à un vrai film de femmes, car ce sont elles qui tiennent les rennes avec ténacité : Michelle Yeoh, donc, et l’incroyable Hsu Hsi-Huan dont la folie contamine l’écran par son seul regard à la fois innocent et morbide. Aux deux hommes forts (Ah-Sheng et Weel King) de succomber à leur charme, bien que la noirceur du récit reprend rapidement le dessus, le film est effectivement imprégné d’une poésie morbide, tout en étant une étrange parade d’héros malades (Drizzle est en temps normal à la retraite, Weel King cherche à retrouver sa virilité, Lei Bin souhaite rentrer auprès de sa femme pour tenir son futur commerce de nouilles, Turquoise n’est plus qu’une orpheline du monde, le magicien n’a jamais su maîtriser le combo kung-fu/magie qui le mènera à sa perte…). Reign of Assassins parvient donc en deux heures à redonner un nouveau souffle au wu xia pian, genre révolutionné et abandonné par Tsui Hark le temps de deux décennies. John Woo avait retrouvé la forme avec ses deux grosses montagnes (Les 3 Royaumes 1&2), c’est aujourd’hui avec le modeste réalisateur Su Chao-Bin qu’il forge les plus beaux sabres du cinéma de ces dernières années.

Deux super-héros de choc : Reign of Assassins
