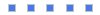

| Astec | 5  |
Le saigneur des rônins... |
| Ordell Robbie | 5  |
Monumental, mis en page d'une façon superbement "cinématographique" |


28 volumes dans sa version bunko, 300 pages de manga dans chaque volume, plus de 8000 pages au total afin d’illustrer une saga qui a subjugué plusieurs millions de lecteurs japonais lors de sa première publication sous forme de serial, dans le magazine Action Comics, au début des années 70...

Lone Wolf and Cub (Kozure Okami) est un monument du manga, un monument de la bande dessinée tout court. Un chef d’œuvre dans le sens plein du terme. De ces œuvres qui suffiraient à justifier «l’œuvre » d’un artiste indépendamment de la qualité du reste de sa production. Quel que soit le bout par lequel on prend ce manga, quel que soit l’angle sous lequel on le considère, rejaillit immanquablement le caractère exceptionnel du travail effectué. Une œuvre d’art digne des plus grands écrivains et conteurs populaires dont seule une industrie réellement populaire peut accoucher, le genre de production qui dépasse inévitablement le statut artisanal de son élaboration ainsi que le statut commercial de sa diffusion pour entrer dans le domaine des grands classiques.
Oui, Lone Wolf and Cub appelle l’exagération, le lyrisme pompier et les figures de style bourrés d’adjectifs dithyrambiques. Le manga de Koike Kazuo et Kojima Goseki mériterait amplement plus qu’une simple critique pour rendre compte de sa richesse et de son exceptionnalité...

A première vue (impression vite confirmée), lorsqu’on s’avise de tourner les pages d’un volume de LWC pris au hasard, le caractère violent de ce manga saute de suite aux yeux, il « gicle » même des nombreuses planches peu avares en jets d’hémoglobine. Quoi de plus normal dans une histoire de samouraïs, de ninjas et de rônins après tout ? Répondant à tous les critères du genre mais à un degré plus élevé, les aventures de Ogami Itto et de son fils Daïgoro satisfont donc pleinement à la feuille de route de tout chambara qui se respecte. Rien que dans cet aspect « fun », ce manga sort du lot par sa capacité à établir des climax « puissamment jouissifs », par la qualité exceptionnelle du dessin de Kojima aussi. Chaque vignette d’une scène de combat irradie l’énergie dégagée par les personnages, capte l’intensité de la concentration et de la détermination de l’un tout en rendant lisible le désespoir face à la mort imminente de l’autre... Toutes les figures de style obligées de ce type de récit sont ainsi utilisées, intégrées puis réinventées par le scénario de Kazuo et la mise en (scène) page « cinématique » de Kojima : les ninjas et leurs multiples techniques d’assassinat et d’espionnage, les duels entre samouraïs, les embuscades en forêt de rônins malfamés, les complots entre seigneurs, les geishas soumises et les femmes guerriers, le moine bouddhiste observant et philosophant (et le faux moine aussi), les grandes batailles et les seppukus honorables... A sa sortie (et encore aujourd’hui) LWC est une des meilleures synthèses du genre, s’appuyant aussi bien sur les travaux d’un pionnier du manga ninja comme Shirato Sanpaï, que sur plus de 30 années de cinéma de genre dédié aux chambara et ninja eiga.

On pourrait en rester là que la note de 5/5 serait encore pleinement justifiée. Car en tant que « simple » manga de samouraï LWC écrase toute concurrence connue à ce jour. Les Kenshin et autres Samourai Deeper Kyo à destination d’un lectorat plutôt jeune sont d’emblée disqualifiés par leur dessin (en comparaison de celui de Lone Wolf) ingrat et sans émotion avant tout, mais aussi par l’immaturité des scénarios au regard de celui de Koike. Quant aux poids lourds récents comme Vagabond ou l’Habitant de l’Infini, si leur exécution graphique se situe à un niveau plus élevé dans leur style respectif, ils sont encore loin d’atteindre le degré de sensualité et la richesse d’informations contenues dans le trait de Kojima : que ce soit dans la représentation de la mort ou de l’amour, son dessin est manifestement le plus « érotique », le plus charnel, en un mot le plus « vrai » de tous. Pour donner dans l’analogie « littéraire » de circonstance, lire LWC dans le genre samouraï c’est un peu comme lire le Seigneur des Anneaux en fantasy : après, tout le reste semble moins bon, pas forcément mauvais mais tout simplement moins bon...

Une des autres forces (et tour de force) de la saga Lone Wolf repose sur la richesse et la complexité d’un background historique qui rend la peinture d’une époque, en l’occurrence le Japon de l’ère Tokugawa en pleine période Edo, partie prenante dans le développement de l’intrigue. La condition d’un rônin se résumant littéralement à une errance infinie sur les routes, c’est donc également l’occasion pour les auteurs de passer en revue les acteurs d’une époque féodale dure et troublée, qui fait d’une stricte stratification sociale la condition essentielle de sa stabilité. Au cours de leur quête de vengeance, Ogami Itto et son fils seront ainsi amenés à côtoyer aussi bien des seigneurs embarqués dans des intrigues de pouvoir (l’occasion aussi de détailler le fascinant fonctionnement du shogounat), ou des paysans souffrant de famine au bord de la révolte, que des représentants de « la lie » de la société : prostituées, maquereaux, chasseurs de prime, voleurs, montreurs de marionnettes pickpockets, arnaqueurs professionnels... (eux aussi soumis à des codes bien définis de fonctionnement selon leur activité). On sent ici l’énorme travail de documentation habilement exploitée dans une perspective « romanesque », car naturellement intégrée au scénario : l’histoire de LWC parle aussi d’Histoire mais sans jamais en faire un élément « en plus » qui viendrait alourdir le récit. D’une structure narrative assez répétitive et linéaire à première vue, LWC recèle en réalité une multitude de rythmes et de temps dans son récit, donnant de la sorte le sentiment au lecteur de ne jamais faire du sur place : il y a les assassinats dont est chargé Itto qui constituent un « fonds » d’histoires surtout dans le premier tiers du manga, l’intrigue principale et la lutte contre le chef du clan Yagyû -Retsudo Yagyû- traitée tout le long des volumes et qui prend énormément d’importance dans le dernier tiers, les nombreux chapitres consacrés à Daigoro, toutes les rencontres avec d’autres personnages qui sont autant d’histoires à raconter...

Il y aurait, dans la richesse des situations et la diversité des personnages traités dans les différents chapitres, matière à faire une collection entière de manga dédiés à cette période particulière de l’histoire du Japon. Mais ce qui fait la sève même du scénario plus que tout autre élément de narration, réside dans la relation qui lie le père (Ogami) et le fils (Daigoro). C’est d’ailleurs l’image emblématique qui reste de LWC : celle d’un rônin poussant un landau de bois et de métal transportant un enfant âgé de 3 ans. C’est dans ce champ du récit qu’explose véritablement tout le talent de dessinateur de Kojima dont le trait et la technique, si proche des traditions picturales japonaises classiques, réussissent à donner vie à un Daigoro plus vrai que nature et donc, à rendre aussi vivante la subtile mais néanmoins forte relation unissant les deux « loups solitaires », le jeune et le vieux. De nombreux chapitres sont ainsi consacrés à l’enfant qui constitue bel et bien un personnage en tant que tel et non un simple « gimmicks » exotique. D’un réalisme saisissant ces chapitres ne marquent pas une pause dans l’intrigue, mais en sont une composante essentielle, au même titre que les chapitres consacrés aux activités de l’assassin Lone Wolf. Au fil des volumes et à mesure que le lecteur entre dans l’intimité de cette relation filiale se dévoile l’ampleur du drame, car c’est bien d’un drame dont il s’agit, qui se joue. Si à première vue « l’impassible » Ogami peut paraître cruel envers son seul et unique enfant par la dureté de son éducation, il obéit à la logique d’une situation qui dans ce Japon féodal ne lui laisse finalement pas énormément de latitude dans la conduite à tenir. Les deux iront donc jusqu’au bout de la voie qu’ils se sont choisis pour accomplir leur vengeance (édifiante scène du choix d’ailleurs...), à savoir la route de Meifumado (celle de l’enfer bouddhiste), la voie de l’assassin..
De nombreux chapitres sont ainsi consacrés à l’enfant qui constitue bel et bien un personnage en tant que tel et non un simple « gimmicks » exotique. D’un réalisme saisissant ces chapitres ne marquent pas une pause dans l’intrigue, mais en sont une composante essentielle, au même titre que les chapitres consacrés aux activités de l’assassin Lone Wolf. Au fil des volumes et à mesure que le lecteur entre dans l’intimité de cette relation filiale se dévoile l’ampleur du drame, car c’est bien d’un drame dont il s’agit, qui se joue. Si à première vue « l’impassible » Ogami peut paraître cruel envers son seul et unique enfant par la dureté de son éducation, il obéit à la logique d’une situation qui dans ce Japon féodal ne lui laisse finalement pas énormément de latitude dans la conduite à tenir. Les deux iront donc jusqu’au bout de la voie qu’ils se sont choisis pour accomplir leur vengeance (édifiante scène du choix d’ailleurs...), à savoir la route de Meifumado (celle de l’enfer bouddhiste), la voie de l’assassin..
La sympathique adaptation de cette œuvre au cinéma (la série des Baby Cart) par le réalisateur Misumi Kenji, malgré la présence de Koike au scénario, n’a jamais vraiment réussi à restituer la noblesse de l’intrigue et ce pour de multiples raisons qui tiennent avant tout à l’époque : au moment où est entreprise cette version grand écran du manga, le genre cinématographique auquel il se rattache a déjà ses plus belles années derrière lui. Le résultat tiendra donc bien plus du « samouraï spaghetti » que du récit épique (en plus d’une erreur de casting manifeste pour le rôle de Ogami, malgré toutes les qualités d’acteur de Wakayama Tomisaburo) en raison d’un traitement de l’image et de la musique très « 70’s » en premier lieu, en raison de la difficulté à faire « jouer » intensément un enfant de 3 ans aussi alors que dans le manga ce dernier exprime, par le truchement du dessin de Kojima et de son trait simple mais toujours juste, une personnalité concernée par les évènements, un personnage réellement autonome, le « co-héro » du récit en quelque sorte.
Le résultat tiendra donc bien plus du « samouraï spaghetti » que du récit épique (en plus d’une erreur de casting manifeste pour le rôle de Ogami, malgré toutes les qualités d’acteur de Wakayama Tomisaburo) en raison d’un traitement de l’image et de la musique très « 70’s » en premier lieu, en raison de la difficulté à faire « jouer » intensément un enfant de 3 ans aussi alors que dans le manga ce dernier exprime, par le truchement du dessin de Kojima et de son trait simple mais toujours juste, une personnalité concernée par les évènements, un personnage réellement autonome, le « co-héro » du récit en quelque sorte.

La belle édition de Dark Horse respecte au plus près (hors sens de lecture originale) le format d’origine (plus petit qu’un livre de poche) et se fend, en plus de lexiques et de notes très complètes en fin de volumes, des couvertures inédites réalisées par de grands noms du Comics pour la première (exécrable mais qui a eu le mérite d’exister) édition partielle du manga aux Etats-Unis, au milieu des années 80. C’est d’ailleurs à l’initiative du célèbre dessinateur de comics Frank Miller, véritablement traumatisé par le travail de Goseki Kojima, que fût entamée cette première édition de LWC à une époque où le manga n’était pas encore publié sur le territoire US. Il est inenvisageable que cette nouvelle réédition de Dark Horse ne connaisse pas un prolongement en France. A quand une version française, au moins d’aussi bonne qualité, de ce chef d’œuvre qui a cumulé les prix aux Etats Unis ces dernières années ?


